Après un début d’année en demi-teintes, février fut court, mais bien meilleur. Surtout au niveau de mes choix.
American bluff — Viva la libertà — Le quepa sur la vilni ! — Hipotesis — Ida — Bethléhem — Only lovers left alive — Les bruits de Recife — The Grand Budapest Hotel
*****

American bluff/American hustle de David O. Russell
Avant toute chose, une ola pour le traducteur du titre. Délibérément bling-bling et de fait, délicieusement vulgaire, le dernier né de David O. Russell est un festival de postiches divers avariés, une occasion d’exploiter à outrance l’abattage d’une Jennifer Lawrence qui a collé ses doigts dans la prise et surtout de débuter par une longue scène où Christian Vouslevoyezbienmonpetitbidon Bale se grime et se prépare à nous entourlouper, mise en abyme du métier de cabotin d’acteur. Jeremy Renner joue un politicien véreux nommé Carmine Polito… on y croit. Fort. Enfin, on essaie. Robert de Niro est The godfather. Non ? Si ! Deux grimaces à l’appui. La bande originale donnerait presque envie de revêtir ses pattes d’eph et de gaufrer ses tifs (yeurk!). Et Amy Adams assoit définitivement son statut de bombe sexuelle. Grande actrice, au demeurant.
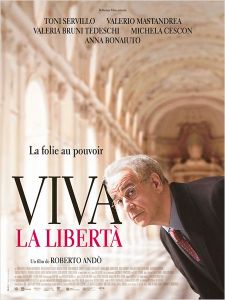
Viva la libertà de Roberto Andò
Un festival Toni Servillo dans le rôle de jumeaux aussi dissemblables que faire se peut. L’un est un vieux routier de la politique fatigué des compromissions, l’autre, un philosophe dépressif bipolaire. Leur point commun, avoir aimé la même femme, Valeria Bruni-Tedeschi. A la disparition impromptue du sénateur, le bouffon devient doublure, et — mais est-ce vraiment une surprise ? — exalte les idéaux tant du parti que de l’électorat anémié par une verve, semble-t-il, retrouvée. Doublée d’un abandon radical de la langue de bois. Tandis que l’autre cavale derrière sa jeunesse sur un plateau de cinéma. Roberto Andò a adapté son propre roman, privilégiant souvent la fantaisie au mépris de la vraisemblance. Peu importe. Une porte s’est entrouverte sur le mystère gémellaire et ses petites rivalités. Le fou rejoint le roi dans sa cavale, ce qui permet au réalisateur d’achever cette comédie des faux-semblants sur une énigme. Dont la résolution est laissée à notre appréciation. Et à notre degré de cynisme.

Le quepa sur la vilni ! de Yann LeQuellec
Moyen métrage découvert en 2013 au Forum des images lors de la reprise de la Quinzaine des Réalisateurs. Une partie de campagne totalement siphonnée dans le Massif des Corbières. On y croise Bernard Menez, ancien facteur — suivez mon regard — et désormais cycliste-sandwich parti promouvoir sur les routes Panique sur la ville ! (Gorilla at large de Harmon Jones), film d’horreur vintage projeté à l’inauguration du cinéma de son village, l’impayable Christophe en extatique maire, Don Quichotte de la cinéphilie, et une bande de jeunes travaillés par leurs hormones et qui se fichent comme d’une guigne de la mission qui leur a été confiée. Sur le chemin, apparaît Bernard Hinault, dans son propre rôle, jamais radin en conseils délirants sommant son premier fan de réveiller le blaireau qui est en lui. Dopé à la chlorophylle, ce road-movie de l’absurde convoque aussi bien Jacques Rozier que les aventures tragico-burlesques d’un Pierre Richard, période lunaire.

Hipotesis/Tesis sobre un homicidio de Hernán Goldfrid
Ricardo Alesyeuxbleus,lesyeuxbleusRicardoa Darin a tant de charisme que désormais les réalisateurs s’imaginent qu’il n’est nul besoin de lui offrir un scénario conséquent à jouer et qu’il suffit juste de le filmer avec tout plein de chichis tout partout, en convoquant une partie de l’équipe ayant participé au triomphe de Dans ses yeux de Juan José Campanella, autrement plus séduisant, pour emporter la partie. Que nenni. Hipotesis ennuie. Outre que les personnages féminins en prennent encore méchamment pour leur grade et que le génie criminel est d’une transparence confondante, notre peu aimable héros boit comme un trou entre deux incartades juridiques, et devant tant d’indigence et d’invraisemblances, c’est nous qui finissons avec la gueule de bois.

Ida de Pawel Pawlikowski
Voici un film qui promettait beaucoup et laisse un goût d’inachevé. Beau noir et blanc, certes, de la couleur des souvenirs enfouis de l’héroïne. Plans léchés, cadres (un peu trop) travaillés où rien n’est laissé au hasard. Dès l’échappée de l’oisillon du nid chrétien qui l’a recueillie, son avenir est tracé. Cernée de toutes parts par son passé, le poids de sa foi, l’inquiétude d’un monde qui ne lui a révélé que sa part de ténèbres, Ida avance sur son inéluctable chemin, comme si elle était damnée dès sa naissance, sans aucun espoir ni bouffée d’air bienvenue. Puisque Ida est déjà morte, enterrée vive dès son plus jeune âge. Le spectateur lui, est sommé de participer à une leçon d’histoire qu’il devine pourtant, bien avant la pauvrette à l’âme sclérosée, tant les révélations et les destins de ceux qui l’entourent sont étrangement téléphonés. Ida ne serait donc qu’une idée, une Némésis, un miroir révélant aux vivants qu’elles croisent, l’assassin antisémite qui jouit impunément de biens volés ou sa tante — l’excellente Agata Kulesza —, femme de chair et de sang, communiste exaltée, l’odieux mensonge qu’est leur vie. Bizarre. Et foutrement déprimant. NB. Faudrait arrêter les superlatifs sur les affiches. C’est agaçant.
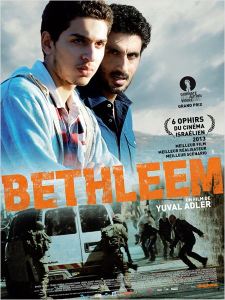
Bethléhem/Bethlehem de Yuval Adler
Premier film au scénario retors et passionnant, Bethléhem nous plonge au cœur de la cité palestinienne vivant au rythme tendu de la seconde Intifada, où les conflits larvés entre militants, terroristes en puissance et membres du Hamas — il faut voir tous ces charognards se disputer, armes à la main, le corps d’un « martyr » — font le miel des agents du Shin-Bet qui recrute des informateurs en loucedé. Razi est de ceux-là, champion de la drague politique, subtile et troublante. Des yeux de velours et un cœur qui balance parfois avec la raison d’état. Ses jeux de séduction et de pouvoir avec Sanfur, un adolescent tombé sous sa coupe lors d’une manipulation de haut vol et depuis, écartelé entre deux feux, instillent un malaise récurrent tant Razi opère sur le gamin qu’il cajole ou menace selon ses besoins une OPA des sentiments, s’amusant avec lui comme le ferait un matou d’un souriceau, sans prendre garde à ses propres carences affectives. Car il s’agit pour Sanfur de se livrer corps et âme à Razi, sans plus de monnaie d’échange que la terreur d’être abattu comme un chien au nom du peuple qu’il trahit. Excellent thriller au suspense soutenu et aux personnages complexes et bien campés par des nouveaux venus, Tsahi Halevi et Shadi Mar’i, Bethléhem a le mérite de renvoyer dos à dos l’hypocrisie de l’autorité palestinienne qui finance le terrorisme pour assurer sa tranquillité et le glaçant cynisme des services secrets israéliens pour qui la fin justifiera toujours les moyens, aussi peu charitables soient-ils.

Only lovers left alive de Jim Jarmusch
Après l’hilarant The limits of control, Jim Jarmusch revient à une veine déambulatoire et plus mélancolique, celle de deux vampires à la croisée des chemins, qui de Détroit, ville désormais fantôme, à Tanger, cité romanesque, tentent de survivre à un monde en déliquescence. Dont l’homme, Adam — Tom Hiddleston en Jim Morrison exsangue et morbide — en proie à un terrible désenchantement, est fatigué. Tandis que sa douce Eve — la toujours énigmatique Tilda Swinton —, dotée d’un tempérament excentrique et rêveur, n’en finit semble-t-il jamais de s’extasier sur la beauté cachée des choses. Tout en se nourrissant de glaces au sang ou en devisant avec Christopher Marlowe, fin lettré et pourvoyeur de sang frais 100% pureté 0% de matière grasse, sur cet impudent Shakespeare qui lui vola ses œuvres. L’arrivée d’une adolescente vorace et vulgaire — Mia Wasikowska, comme échappée de True blood, aime à se nourrir « à l’ancienne » — va précipiter leur exil, sur un rivage inconnu, où ils vont se réchauffer aux rythmes lancinants de la musique berbère et réapprendre le b.a.-ba du comportement vampirique. Bourré d’humour, de musique et de nostalgie tout en jouant sur la délicatesse inhérente aux psychés anciennes, Only lovers left alive exalte l’amour fou tandis que les rêves et les passions humaines sont jugés à l’aune du temps qui passe. Inexorablement.

Les bruits de Recife/O Som ao Redor de Kleber Mendonça Filho
Dans la ville de Récife, les chiens aboient, les sociétés de sécurité prospèrent. Dans un quartier petit-bourgeois de la ville, les esprits s’échauffent et la colère gronde. Surtout que les jappements n’inquiètent guère les malandrins et que d’étranges créatures peuplent les arbres environnants. Mélange de vie de quartier, d’enfer sécuritaire et de mafia mal digérée — les patrons méprisants d’aujourd’hui n’étant jamais que les descendants des propriétaires de plantations d’autrefois —, Les bruits de Récife exhalent une étrangeté fantasmatique et un malaise des plus sournois. Surtout quand les sons s’absentent. Les rancœurs mises à jour révèlent un passé trouble dont les blessures n’ont pas encore été sérieusement pansées, et le réalisateur en profite pour nous perdre dans les dédales architecturaux d’une société en pleine expansion, où les dérives sécuritaires de milices privées génèrent une inquiétude sourde, doublée d’une violence de classes terrifiante. Kleber Mendonça Filho signe un premier film subtil et fascinant qui nécessite plusieurs visions tant il est complexe et riche en interrogations.

The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson
Le grand éclat de rire du mois, souvent tempéré par le sentiment de tristesse qui nous étreint en songeant aux abîmes de terreur dans lesquels va plonger l’Europe. D’ailleurs, un bruit de bottes absurde pointe déjà à l’horizon. Mais en attendant, place aux aventures de l’élégant et fantasque Gustave — un Ralph Fiennes déchainé que l’on ne connaissait pas sous un jour si farfelu —, concierge d’un crémeux loukoum rose palace en voie de perdition et de son lobby boy, Zéro, jeune réfugié aux origines indéterminées qu’il a pris sous son aile accueillante. S’ensuit une rocambolesque histoire de tableau volé à une vieille cliente richissime — Tilda Swinton, dans sa veine Me reconnaissez vous ? entamée avec Snowpiercer de Bong Joon-ho —, qui déshérite un fils indigne et revanchard pour faire de l’homme qui a réveillé en elle un volcan qu’elle croyait éteint son légataire universel. Bienvenue dans le monde délirant et pourtant chagrin — héritage de Stefan Zweig dont les écrits tragiques ont inspiré le réalisateur — de Wes Anderson, qui dégorge de masques, de faux-semblants, d’espions en goguette, de farces et attrapes, de gags, de roi de l’évasion et d’une panoplie d’hommes moustachus — vivaces apparitions du trio de complices Murray-Wilson-Schwartzman — à faire rêver la vitrine d’un barbier. Jamais fin d’un monde ne fut plus burlesque. Deux scènes résolument cultes à retenir parmi d’autres : un jet expéditif de matou par la fenêtre sous les yeux incrédules de son maitre et une course-poursuite insensée en skis réalisée en stop motion à faire pâlir d’envie Mack Sennett.
*****
Si vous avez raté le début de la rétrospective 2014 :
A suivre…
